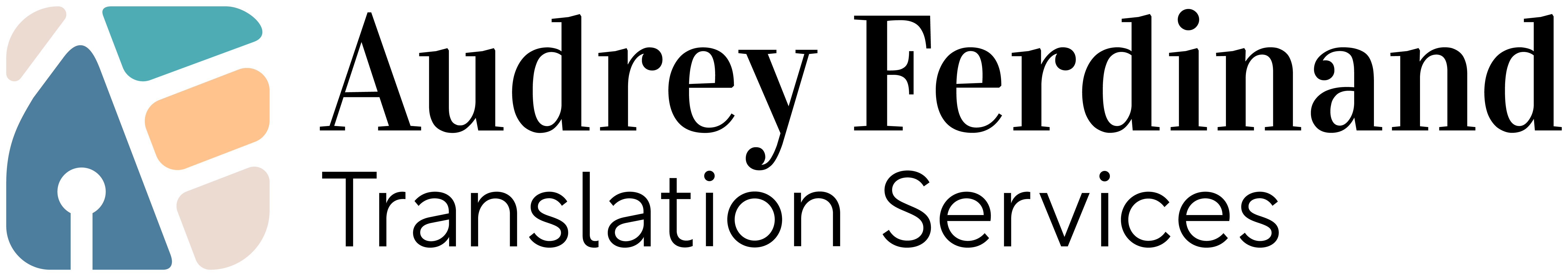Ce blog propose des articles thématique basés sur l’actualité et qui cherchent à expliquer le contexte entourant ces actualités.
*an English version on this article is available > here <
Au début du mois, un accord a été conclu au sein de l’ONU (Organisation des Nations Unies) relatif à la protection de la haute mer (« accord » ou « traité »). Cet accord est l’aboutissement de plus de 20 années de discussions et marque une étape importante dans la protection de la haute mer.
Quelques questions se posent alors :
- Qu’est-ce que la haute mer ?
- Pourquoi un tel accord était-il nécessaire ?
- Que comprend l’accord ?
- Cela va-t-il avoir un impact sur la lutte contre les changements climatiques ?
Qu’est-ce que la « haute mer » ?
Pour rappel, une partie des mers (faisant ici références à toutes sources d’eau, rivières, mers et océans) est sous la juridiction des États. Comment est-ce possible ? Les États ont des droits sur les eaux entourant leur territoire terrestre ; ces eaux font partie du territoire de l’État jusqu’à 200 milles marins, équivalant à 370,4 km, et le reste forme la haute mer.
Processus menant à l’adoption de cet accord ; pourquoi était-il nécessaire ?
Règlementation des mers
Au XVIIème siècle, deux notions s’opposaient : mare clausum et mare liberum (la souveraineté sur les mers et la liberté d’exploitation des mers).
À la fin du XVIIIème siècle, il a été admis que les deux notions n’étaient pas exclusives, mare liberum renvoyant au principe de liberté de la mer et au développement du commerce maritime international, et mare clausum à la souveraineté des États sur les zones proches de leurs côtes. Cela a été inscrit dans la Convention de Montego Bay, et a valeur de droit coutumier pour les États ne l’ayant pas ratifiée.
La Convention de Montego Bay de 1982 (dont le nom entier est Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en vigueur depuis 1994) prévoit que :
- L’État côtier a souveraineté sur 200 milles marins comme suit :
- la mer territoriale (12 milles marins)
- la zone économique exclusive (188 milles marins)
- Le reste forme la haute mer.
La haute mer forme ainsi 60 pour cent des mers ! Elle est pourtant très peu règlementée, ce qui laisse la voie à des activités de pêche illicite ou des activités menant à une perte de la biodiversité. Cela a également eu des répercussion sur l’économie de certains États côtiers, dont les ressources sont essentiellement marines, du fait de l’épuisement rapide des réserves de poissons.
Comme les États n’ont pas souveraineté sur la haute mer, celle-ci et ses ressources sont exploitées en vertu du principe de gestion commune.
Afin de mieux règlementer et encadrer l’utilisation et l’exploitation des ressources de la haute mer, d’autres accords ont été adoptés, tels que :
- Code de conduite de la FAO pour une Pêche Responsable, 1995 ;
- Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zone économique exclusive, 1995.
Toutefois, un traité spécifiquement sur la haute mer (qui, encore une fois, représente 60 % des mers !) et adopté au niveau international était jugé nécessaire et en discussion depuis 2004.
Étapes clés dans l’adoption du traité sur la haute mer
- En 2015, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 69/292, qui a énoncé l’objectif de l’adoption d’un instrument international contraignant sur la biodiversité marine. Un comité a été formé pour atteindre cet objectif.
- En 2017, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 72/249, qui crée la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ en anglais). L’objectif de la BBNJ est d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant (un traité) sur la base des recommandations faites par le comité susmentionné.
- En 2022, les États se sont engagés, à la conférence de l’ONU sur la biodiversité, à protéger un tiers des mers d’ici 2030.
- Le 4 mars 2023, les États membres de l’ONU ont adopté, à l’assemblée générales des Nations Unies, le traité sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (traité sur la haute mer).
L’adoption de cet accord au sein de l’assemblée générale des Nations Unies signifie qu’il a été accepté par une majorité des 193 États membres de l’ONU. Une telle acceptation pourrait mener, comme cela a été le cas avec la Convention de Montego Bay, à donner une valeur coutumière aux dispositions du traité (tous les États devraient alors les respecter).
Toutefois, l’accord a été accepté mais pas encore ratifié par les États : 60 ratifications sont nécessaires à son entrée en vigueur.
Que comprend cet accord ?
L’accord fait 54 pages et n’est pour l’instant pas disponible en français. Il fait référence à de nombreuses problématiques liées aux mers, dont l’économie, la pollution et la biodiversité. Ci-dessous, sous chaque titre du traité sont mentionnés quelques points clés :
Préambule
- Il fait référence à la perte de biodiversité, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, et à la pollution, ainsi qu’aux peuples autochtones et à la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones.
- Le préambule se termine sur ces deux phrases : « Déterminé à parvenir à un développement durable, Aspirant à une participation universelle, » ce qui signifie que ce traité a un objectif de durabilité, aligné sur les objectifs de développement durable (ODD) et énonce des règles et principes devant être internationalement reconnus et acceptés (et devenir ainsi du droit coutumier ?)
Partie I Dispositions générales
- L’accord utilise une définition négative de la haute mer, comme c’était le cas dans la Convention de Montego Bay, en disant qu’il s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il inclut également les zones marines protégées dans cette définition (articles 1 et 3).
- Son objectif est le suivant : assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité marine biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (de la haute mer), immédiatement et à long terme.
- La mise en œuvre du traité est basée sur 13 principes, listés à l’article 5 :
(a) Le principe du pollueur-payeur ;
(b) Le principe de l’héritage commun de l’humanité ;
(b) bis. La liberté de la recherche scientifique marine, ainsi que d’autres libertés en haute mer ;
(c) Le principe d’équité et le partage juste et équitable des avantages ;
(d) Le principe ou l’approche de précaution, selon le cas ;
(e) Une approche écosystémique ;
(f) Une approche intégrée de la gestion des océans ;
(g) Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, y compris face aux effets néfastes des changements climatiques et de l’acidification des océans, et qui maintient et restaure l’intégrité des écosystèmes, y compris les services du cycle du carbone qui sous-tendent le rôle de l’océan dans le climat ;
(h) L’utilisation des meilleures informations scientifiques disponibles ;
(i) L’utilisation des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, le cas échéant ;
(j) Le respect, la promotion et la prise en compte de leurs obligations respectives, selon le cas, relatives aux droits des peuples autochtones ou, le cas échéant, des communautés locales lorsqu’ils prennent des mesures pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
(k) Le non-transfert, direct ou indirect, de dommages ou de risques d’une zone à une autre et la non-transformation d’un type de pollution en un autre, en prenant des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ;
(l) La pleine reconnaissance de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ;
(m) La reconnaissance des intérêts et besoins particuliers des pays en développement sans littoral.
Partie II Ressources génétiques marines, incluant le partage juste et équitable des bénéfices
- Cette partie pose l’idée d’une répartition équitable des bénéfices provenant d’activités liées aux ressources génétiques marines et aux séquences d’informations numériques sur les ressources génétiques marines (article 7). À cet égard, un comité sur le partage des bénéfices est créé par l’article 11bis de l’accord, auquel les États feront régulièrement rapport (article 13).
- Elle fait également référence au savoir traditionnel des peuples autochtones quant aux ressources génétiques marines (article 10bis).
Partie III Mesures telles que les outils de gestion par zones, y compris des zones marine protégées
- Cette partie traite de la possibilité de créer des outils de gestion des zones aidant à la conservation et à l’utilisation durable des zones nécessitant une protection, et de renforcer la coopération et la coordination entre les États quant à l’usage de ces outils.
- Elle prévoit également des mesures d’urgence (article 20) adoptées par la Conférence des parties lorsqu’un phénomène naturel ou catastrophe causée par l’homme cause ou est susceptible de causer un dommage grave ou irréversible à la diversité biologique marine des zones en dehors de la juridiction nationale, afin de s’assurer que ce dommage grave ou irréversible ne soit pas exacerbé.
Partie IV Évaluation de l’impact sur l’environnement
- Les évaluation de l’impact sur l’environnement sont définis dans l’accord comme un processus visant à identifier et évaluer les effets potentiel d’une activité afin d’éclairer la prise de décision (article 1).
- L’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement est énoncée à l’article 22, afin d’évaluer l’impact possible d’une activité, et d’en faire rapport. Ces évaluations doivent être rendues publiques.
- Une fois que l’activité est lancée, les États doivent surveiller la mise en œuvre de ces activités (l’accord fait ici à nouveau référence aux connaissances des peuples autochtones dans l’identification des impacts sur l’environnement), examiner leurs impacts, et effectuer des évaluations environnementales stratégiques.
- Un organe scientifique et technique est également créé et est chargé de développer des normes et directives pour la conduite des évaluations de l’impact sur l’environnement, lesquelles seront adoptées par la Conférence des parties (article 41bis).
Partie V Renforcement des capacités et transfert des technologies marines
- Cette partie vise à développer les connaissances et la recherche concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine ainsi que le développement des capacités scientifiques et technologiques marines, et la coopération entre les États à cet égard.
- Elle établit un comité de renforcement des capacités et de transfert des technologies marines pour aider à atteindre ces objectifs et faire des rapports.
Part VI Dispositions institutionnelles
- Cette partie établit une Conférence des parties (COP) uniquement dédiée aux problématiques traitées par cet accord (article 48). Cette COP est chargée d’examiner et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord.
- Dans l’exercice de ses fonctions, elle peut demander un avis consultatif au tribunal international du droit de la mer sur une question juridique relative à la conformité avec l’accord d’une proposition soumise à la Conférence des Parties sur toute question relevant de sa compétence.
- Un centre d’échange est établi sous la forme d’une plate-forme en libre accès permettant aux États de diffuser des informations et d’assurer plus de transparence, entre autres.
Partie VII Ressources et mécanisme financier
- Les mécanismes établit par l’accord sont financés par les contributions des Parties, et un mécanisme pour les ressources financières est créé.
Partie VIII Mise en œuvre et respect
- Cette partie crée un comité de la conformité visant à faciliter et étudier la mise et œuvre de l’accord et promouvoir le respect de ses dispositions d’une manière transparente, ni accusatoire, ni punitive ; l’accord ne prévoit donc pas de sanctions ni de recours en cas de non-respect de l’accord.
Partie IX Règlement des différends
- Elle rappelle l’obligation de régler pacifiquement les différends, et établit une procédure pour cela.
Partie X Non-parties à l’accord
- Elle encourage les États non-parties à l’accord à devenir parties.
Partie XI Bonne foi et abus de droits
- Les Parties doivent mettre en œuvre cet accord de bonne foi et respecter leurs obligations.
Partie XII Dispositions finales
- L’accord est accepté dans son entier, les Parties ne peuvent émettre des réserves.
Annexes
- Annexe 1 Critères indicatifs pour les zones d’identification
- Annexe 2 Types de renforcement des capacités et de transfert de technologie marine
Cela va-t-il avoir un impact sur la lutte contre les changements climatiques ?
Le traité sur la haute mer fait référence à la pollution, à la protection des écosystèmes et de la biodiversité marine, et inscrit l’obligation de mener une évaluation avant d’entreprendre une activité, puis de surveiller et examiner l’impact réel de ladite activité sur la haute mer. Il prévoit également la possibilité pour cette nouvelle COP de prendre des mesures d’urgence avant, pendant ou après qu’une catastrophe d’origine humaine ou naturelle impacte l’écosystème marin de la haute mer. Cela représente clairement une avancée dans la protection de la haute mer contre des activités et projets non durables et ne prenant pas en compte l’environnement marin.
Toutefois, la principale lacune de ce traité est l’absence de sanction en cas de non-respect des dispositions du traité, malgré la création de nombreux comités surveillant cette mise en œuvre.
Sources
Conventions et autres accords
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay), 1982 https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2009/416/20200706/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2009-416-20200706-fr-pdf-a.pdf
Traité sur conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Traité sur la haute mer), 4 mars 2023 (Titre anglais : Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction) https://www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/draft_agreement_advanced_unedited_for_posting_v1.pdf
Informations générales
Nations Unies, Question thématiques – Océans et droit de la mer https://www.un.org/fr/global-issues/oceans-and-the-law-of-the-sea
FAO, Code de conduite pour la pêche responsable 1995 https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/code-of-conduct-for-responsible-fisheries/fr/
Nations Unies, Accord pour l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 1995 https://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/un-fish-stocks-agreement/fr/
Traité international de protection de la haute mer : un accord historique, 6 mars 2023 https://www.vie-publique.fr/en-bref/288478-traite-international-de-protection-de-la-haute-mer-accord-historique
Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale https://www.un.org/bbnj/fr
Articles
Le Monde, Biodiversité : une étape décisive pour le traité sur la haute mer (4 mars 2023) https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/03/04/biodiversite-une-etape-decisive-pour-le-traite-sur-la-haute-mer_6164126_3244.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
ONU, Accord historique à l’ONU sur la protection de la biodiversité marine en haute mer (5 mars 2023) https://news.un.org/fr/story/2023/03/1132947
Le Monde, Ce que prévoit le traité sur la haute mer, étape historique dans la protection des océans (9 mars 2023) https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/03/09/protection-des-oceans-ce-que-change-le-traite-sur-la-haute-mer_6164762_3244.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D